« Contagions » de Paolo Giordano
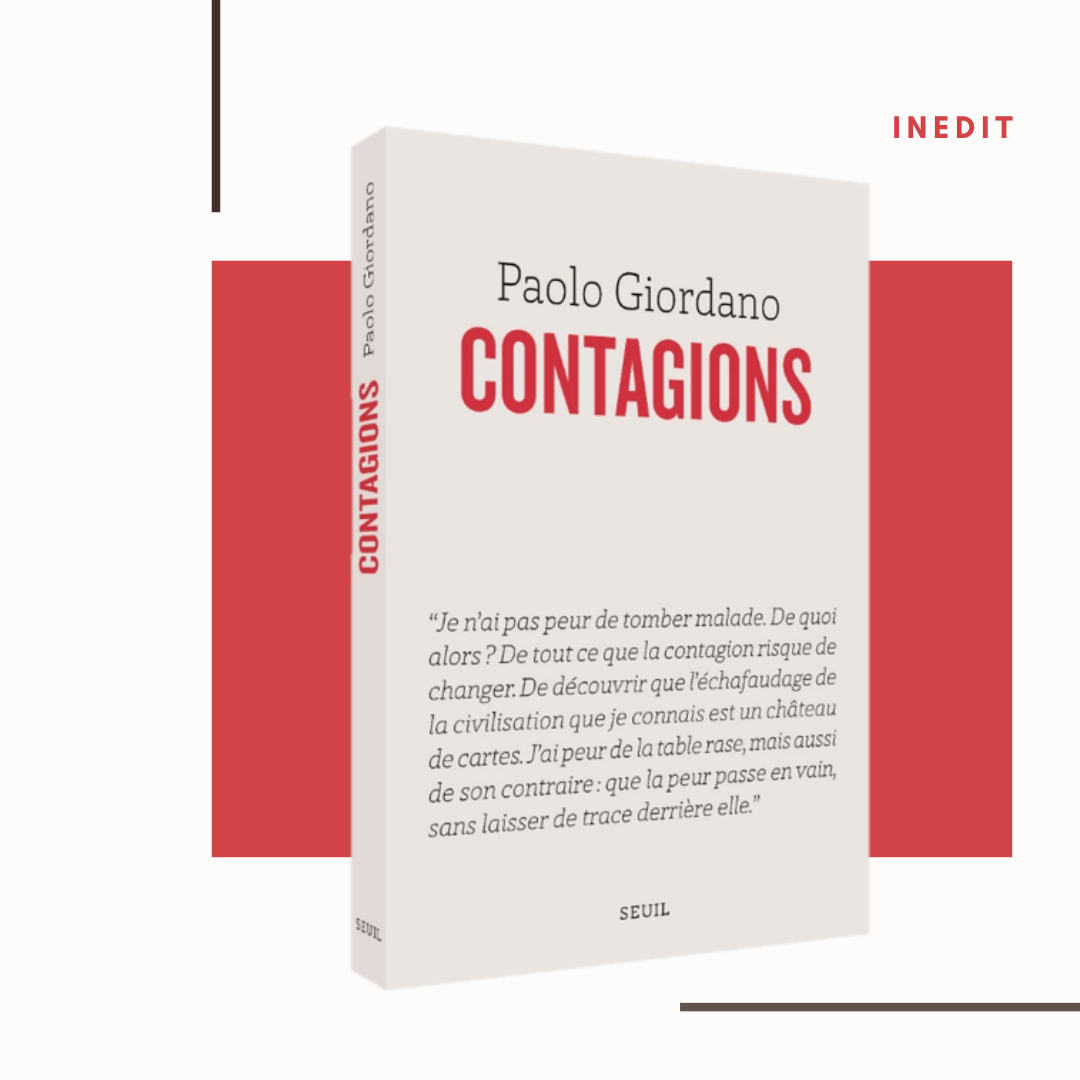 Né à Turin en 1982, docteur en physique théorique et romancier, Paolo Giordano a gagné une réputation mondiale dès son premier livre, La Solitude des nombres premiers (2008). On lui doit ensuite Le Corps humain (2013), Les Humeurs insolubles (2015) et Dévorer le ciel (2019).
Né à Turin en 1982, docteur en physique théorique et romancier, Paolo Giordano a gagné une réputation mondiale dès son premier livre, La Solitude des nombres premiers (2008). On lui doit ensuite Le Corps humain (2013), Les Humeurs insolubles (2015) et Dévorer le ciel (2019).
Entre le 29 février et le 6 mars, juste avant que l’Italie n’entre en confinement total, Paolo Giordano a écrit Contagions. Cet essai est le prolongement d’un article qu’il a publié le 25 février dans le quotidien milanais Corriere della Sera, dans lequel il expliquait, à partir de statistiques, pourquoi les gens devaient rester isolés. Le texte, lu 3,5 millions de fois sur le site du journal, lui a donné « l’élan nécessaire » pour écrire cet essai, qui croise les mathématiques, l’écologie et l’information. « Ce petit livre est, dans une certaine mesure, le point final soudain à une entreprise qui a commencé, pour moi, il y a bien longtemps. »
En Italie, Contagions sortira le 26 mars chez Einaudi en e-book, en collaboration avec le Corriere della Sera – l’auteur reversera une partie de ses droits d’auteur pour la gestion de l’urgence sanitaire et la recherche scientifique. En France, le Seuil met Contagions en libre accès sur son site dès le 24 mars, avant une sortie ultérieure en librairie.
Voici quelques extraits que Le Monde a publié.
Rester à terre
“ En ce rare 29 février, un samedi de cette année bissextile, où j’écris, les contagions confirmées dans le monde ont dépassé la barre de 85 000 – près de 80 000 dans la seule Chine – et le nombre de morts approche les 3 000. Cela fait plus d’un mois que cette étrange comptabilité tient lieu d’arrière-fond à mes journées. A cet instant aussi, je regarde la carte interactive de la Johns Hopkins University. Des cercles rouges se détachant sur un fond gris signalent les zones de diffusion : les couleurs de l’alarme, qu’on aurait pu choisir avec plus de sagacité. Mais, c’est bien connu, les virus sont rouges, les urgences sont rouges. Si la Chine et le Sud-Est asiatique ont disparu sous une unique grande tache, le monde entier est grêlé, et le rash [terme médical désignant une éruption cutanée] s’aggravera inéluctablement.
L’Italie, à la surprise de bon nombre d’observateurs, s’est retrouvée sur le podium de cette compétition anxiogène. (…) Mes rendez-vous des prochains jours ont été annulés en vertu des mesures de confinement ; j’en ai moi-même repoussé d’autres. J’ai échoué dans un espace vide inattendu. C’est un présent largement partagé : nous traversons un intervalle de suspension de notre quotidien, une interruption de notre rythme, comme dans certaines chansons, lorsque la batterie cesse et que la musique semble se dilater. Etablissements scolaires fermés, de rares avions dans le ciel, des pas solitaires et sonores dans les couloirs des musées, partout plus de silence que d’habitude.
J’ai décidé d’employer ce vide à écrire. Pour tenir à distance les présages et trouver une meilleure façon de réfléchir à tout cela. L’écriture a parfois le pouvoir de se muer en un lest qui ancre au sol. Ce n’est pas tout : je ne veux pas passer à côté de ce que l’épidémie nous dévoile de nous-mêmes. Une fois la peur surmontée, les idées volatiles s’évanouiront en un instant – il en va toujours ainsi avec les maladies.
Quand vous lirez ces pages, la situation aura changé. Les chiffres seront différents, l’épidémie se sera étendue, elle aura atteint tous les coins civilisés du monde, ou aura été domptée – peu importe. Les réflexions que la contagion suscite maintenant seront encore valables. Car nous n’avons pas affaire à un accident fortuit ou à un fléau. Ce qui arrive n’a rien de nouveau : cela s’est déjà produit et cela se reproduira.
Des après-midis de nerd[1]
Je me rappelle certains après-midis, en seconde et en première, passés à simplifier des expressions. Recopier une longue série de symboles contenus dans un livre puis, pas à pas, la réduire à un résultat concis et compréhensible : 0, -½, a2. Derrière la fenêtre, la nuit tombait et le paysage laissait place au reflet de mon visage éclairé par la lampe. C’étaient des après-midi de paix. Des bulles d’ordre à un âge où tout, en moi et hors de moi – surtout en moi –, semblait virer au chaos. Bien avant l’écriture, les mathématiques m’ont permis de réfréner l’angoisse. Il m’arrive encore, le matin au réveil, d’improviser des calculs et des successions de nombres : c’est en général le signe que quelque chose cloche. Je suppose que cela fait de moi un nerd. Je l’accepte. Et j’assume pour ainsi dire cet embarras. Or, il se trouve qu’en ce moment les mathématiques ne sont pas seulement un passe-temps à l’usage des nerds : elles sont l’instrument indispensable pour comprendre la situation et se débarrasser des suggestions.
Avant d’être des urgences médicales, les épidémies sont des urgences mathématiques. Car les mathématiques ne sont pas vraiment la science des nombres, elles sont la science des relations : elles décrivent les liens et les échanges entre différentes entités en s’efforçant d’oublier de quoi ces entités sont faites, en les rendant abstraites sous forme de lettres, de fonctions, de vecteurs, de points et de surfaces. La contagion est une infection de notre réseau de relations.
La mathématique de la contagion
Elle était visible à l’horizon comme un amoncellement de nuages, mais la Chine est loin, et puis pensez-vous… Quand la contagion a fondu sur nous, elle nous a étourdis.
Pour dissiper mon incrédulité, j’ai cru bon de recourir aux mathématiques à partir du modèle SIR [modèle mathématique des maladies infectieuses], l’ossature transparente de toute épidémie (…).
Le CoV-2 [le SARS-CoV-2, le type de coronavirus qui provoque l’épidémie de Covid-19] est la forme de vie la plus élémentaire que nous connaissions. Afin de comprendre son action, nous devons adopter son intelligence limitée, nous voir ainsi qu’il nous voit. Et nous rappeler que le CoV-2 ne s’intéresse guère à nous, à notre âge, à notre sexe, à notre nationalité ou à nos préférences. Pour le virus, l’humanité entière se partage en trois groupes : les Susceptibles, c’est-à-dire tous ceux qu’il pourrait encore contaminer ; les Infectés, c’est-à-dire ceux qu’il a déjà contaminés ; et les Rejetés, ceux qu’il ne peut plus contaminer.
Susceptibles, Infectés, Rejetés : SIR.
D’après la carte de la contagion qui vibre sur mon écran, le nombre des Infectés dans le monde s’élève, à cet instant, à environ 40 000 ; celui des Rejetés, morts ou guéris, est légèrement supérieur.
Mais c’est l’autre groupe qu’il faut surveiller, celui qu’on ne mentionne pas. Les Susceptibles, les êtres humains que le CoV-2 pourrait encore infecter, constituent une population d’un peu moins de 7 milliards et demi d’individus.
Dans ce drôle de monde non linéaire
L’après-midi, j’attends le bulletin de la Protection civile. C’est tout ce qui m’intéresse désormais. D’autres événements continuent de se produire dans le monde, ils sont importants et les actualités les relatent, mais je ne les regarde même pas.
Le 24 février, le nombre d’Infectés avérés en Italie était de 231. Le lendemain, il avait grimpé à 322. Le surlendemain, à 470 ; puis à 655, à 888, à 1 128. Aujourd’hui, un 1er mars pluvieux, il est de 1 694. Ce n’est pas ce que nous souhaiterions. Et pas non plus ce que nous prévoyions (…). Lorsque quelque chose croît, nous sommes enclins à penser que sa croissance sera égale jour après jour. Pour le dire en termes mathématiques, nous nous attendons toujours à une avancée linéaire. C’est plus fort que nous.
Or, l’augmentation des cas est de plus en plus grande. Elle semble incontrôlable. J’aurais tendance à ajouter : c’est un des moyens que le virus a trouvés pour nous désarçonner, mais ce serait une concession excessive à son intelligence limitée. En réalité, la nature elle-même n’est pas structurée de façon linéaire. La nature préfère les croissances vertigineuses, ou résolument plus douces, les exposants et les logarithmes. La nature est par nature non linéaire.
Les épidémies ne font pas exception à la règle. Toutefois, un comportement qui ne surprend pas les scientifiques peut atterrer tous les autres. L’augmentation des cas devient ainsi « une explosion » ; dans les titres des journaux, elle est « inquiétante », « dramatique », alors qu’elle était juste prévisible. C’est la distorsion de ce qui est normal qui engendre la peur. Les cas de Covid-19 n’augmentent pas de manière constante en Italie ni ailleurs ; dans cette phase, ils augmentent beaucoup plus rapidement, et cela n’a rien, mais vraiment rien, de mystérieux.
Se souhaiter le meilleur
Hier, je suis allé dîner chez des amis. C’est la dernière fois, me suis-je dit. Quand la barre des 2 000 contagions sera franchie, je me mettrai en quarantaine. En entrant, je n’ai embrassé personne, ce qui a un peu vexé les convives. En réalité, ils étaient surtout perplexes. Cette épidémie semble m’avoir pris la tête plus qu’elle ne le devrait. Je suis plutôt hypocondriaque, je demande un soir sur deux à ma femme de me tâter le front, pourtant il ne s’agit pas de ça. Je n’ai pas peur de tomber malade. De quoi, alors ? De tout ce que la contagion risque de changer. De découvrir que l’échafaudage de la civilisation que je connais est un château de cartes. J’ai peur de la table rase, mais aussi de son contraire : que la peur passe en vain, sans laisser de trace derrière elle.
Au dîner, tout le monde répétait : « Dans une semaine, ce sera terminé », « Mais si, tu verras, encore quelques jours et tout retournera à la normale. » Une amie m’a demandé pourquoi je gardais le silence. Je me suis borné à hausser les épaules, je n’avais pas envie de jouer l’alarmiste, pis, l’oiseau de mauvais augure.
Si nous n’avons pas d’anticorps contre le CoV-2, nous en avons contre tout ce qui nous déconcerte. Nous voulons toujours connaître les dates de début et de fin des choses. Nous sommes habitués à imposer notre rythme à la nature, et non le contraire. J’exige donc que la contagion s’achève dans une semaine, qu’on retourne à la normale. Je l’exige en l’espérant.
Mais, dans la contagion, nous avons besoin de savoir ce qu’il est légitime d’espérer. Car il n’est pas dit que se souhaiter le meilleur et se le souhaiter de la bonne façon correspondent. Attendre l’impossible, ne serait-ce que le hautement improbable, nous expose à une déception répétée. Le défaut de la pensée magique, dans ce genre de crise, n’est pas tant d’être fausse que de nous conduire tout droit vers l’angoisse.
Arrêter vraiment la contagion
« Alors, comment arrête-t‑on vraiment la contagion ?
– Par un vaccin.
– Et s’il n’y a pas de vaccin ?
– Par davantage de patience. »
Les épidémiologistes savent que le seul moyen de stopper l’épidémie est de réduire le nombre de Susceptibles. Leur densité dans la population doit s’amenuiser de façon à rendre la diffusion improbable. (…)
Les vaccins ont le pouvoir mathématique de nous faire passer de la catégorie Susceptibles à la catégorie Rejetés sans que nous ayons à traverser la maladie. Ils nous intéressent parce qu’ils nous sauvent du virus, mais ils intéressent encore plus les infectiologues parce qu’ils nous sauvent de l’épidémie. Il ne serait même pas nécessaire d’être tous vaccinés, il suffirait que nous le soyons selon un pourcentage significatif, atteindre ce que l’on appelle l’« immunité grégaire ».
Or, le CoV-2 bénéficie de la chance des débutants. Il nous a surpris impréparés et vierges, sans anticorps ni vaccin. Il est trop nouveau pour nous. Traduite en modèle SIR, cette charge de nouveauté signifie que nous sommes tous Susceptibles.
Voilà pourquoi nous devrons résister le temps nécessaire. Le seul vaccin dont nous disposons est une forme un peu désagréable de prudence.
La mathématique de la prudence
Je voulais arriver à la montagne à tout prix. Ces vacances étaient une récompense après la session d’examens. Mes amis y tenaient autant que moi, sans compter que tout était déjà payé, l’hôtel aux Deux Alpes et même, par un excès d’audace, le ski-pass hebdomadaire. A la sortie du tunnel de Salbertrand, nous avons été pris dans une tempête de neige. Elle venait probablement de débuter, car la chaussée était encore nette. Nous nous sommes dit : « On va passer. » Dix kilomètres plus loin, nous étions derrière une file d’autres voitures à l’arrêt. Nous avons monté les chaînes, avec tous les efforts que cela implique, en particulier quand c’est la première fois. Au moment de repartir, nous avions de la neige jusqu’aux chevilles. J’ai téléphoné à mon père. Sur un ton très paisible, il m’a dit que, dans certaines situations, le seul courage possible consiste à renoncer.
Je lui dois cette leçon de prudence et, plus encore, son fondement mathématique.
L’excès de vitesse a toujours compté parmi ses obsessions. Quand, sur l’autoroute, une voiture fonçant comme un missile nous dépassait, il répétait que son conducteur ignorait de toute évidence que la violence d’un choc n’augmente pas proportionnellement à la vitesse, mais à son carré. J’étais enfant, je ne disposais pas des notions indispensables pour donner un sens à cette phrase, loin de là. Je l’ai réinterprétée des années plus tard à la lumière de la physique. Dans la formule de l’énergie cinétique, celle d’un corps en mouvement, ce n’est pas la vitesse qui apparaît, mais son carré : E = 1/2 mv2
Ainsi, le choc était l’énergie, et mon père me parlait de la différence entre une croissance linéaire et une croissance non linéaire. Il me signalait que la pensée intuitive est parfois erronée. Faire un excès de vitesse sur l’autoroute n’était pas plus dangereux que je ne le croyais : c’était beaucoup, beaucoup plus dangereux.
Pied-main-bouche
A Milan, on a fermé les écoles, les universités, les musées, les théâtres, les salles de sport. Je reçois sur mon téléphone portable des photos de la désolation dans les rues du centre-ville. Le 15 août, un 2 mars. Ici, à Rome, on respire encore un air de normalité, mais c’est une normalité conditionnée. Partout, on perçoit l’arrivée du changement.
La contagion a déjà compromis nos liens. Et apporté une grande solitude : la solitude des malades dans les unités de soins intensifs, qui communiquent à travers une vitre, et une autre, diffuse, celle des bouches cachées derrière les masques, des regards soupçonneux, de l’obligation de rester chez soi. Dans la contagion, nous sommes tous libres et assignés à résidence.
Une semaine avant mon douzième anniversaire, j’ai attrapé une maladie qu’on appelle pied-main-bouche. Des boutons sont apparus, justement, autour de mes lèvres et à mes extrémités. Je n’avais pas de fièvre, je n’étais même pas souffrant, démangeaisons exceptées, mais comme c’était un syndrome très contagieux, j’ai été placé dans une sorte d’isolement domestique. Quand je quittais ma chambre, je devais enfiler des gants en tissu blanc, tel l’homme invisible. C’était une maladie exanthématique toute bête, et pourtant je me sentais très seul, humilié, et j’ai pleuré le jour de mon anniversaire, je m’en souviens.
Personne n’aime être exclu. Et savoir que notre séparation du monde est transitoire ne suffit pas à effacer notre souffrance. Nous éprouvons un besoin désespéré d’être avec les autres, parmi les autres, à moins d’un mètre des personnes qui ont de l’importance pour nous. C’est une exigence constante qui ressemble à la respiration.
Contre le fatalisme
L’épidémie nous encourage à nous considérer comme les membres d’une collectivité. Elle nous oblige à accomplir un effort d’imagination auquel nous ne sommes pas accoutumés : voir que nous sommes inextricablement reliés les uns aux autres et tenir compte de la présence d’autrui dans nos choix individuels. Dans la contagion, nous sommes un organisme unique. Dans la contagion, nous redevenons une communauté. (…)
Lors d’une épidémie, les Susceptibles doivent se protéger également pour protéger les autres. Les Susceptibles constituent aussi un cordon sanitaire.
Ainsi, dans la contagion, ce que nous faisons ou nous abstenons de faire ne nous concerne plus exclusivement. C’est une chose que j’aimerais ne pas oublier, y compris quand tout sera terminé.
Alors je cherche une formule concise, un slogan à mémoriser et je le trouve dans un article de Science datant de 1972 : More Is Different (« Plus est différent »). Philip Warren Anderson l’a écrit à propos des électrons et des molécules, mais il parlait aussi de nous : l’effet cumulatif de nos actions singulières sur la collectivité est différent de la somme des effets singuliers. Si nous sommes nombreux, chacun de nos comportements a des conséquences globales abstraites et difficiles à concevoir. Dans la contagion, l’absence de solidarité est avant tout un manque d’imagination.
Aucun homme n’est une île
Quand j’étais au lycée, il y avait de nombreuses manifestations contre la mondialisation. Je n’ai participé qu’à une seule d’entre elles, et j’ai été déçu. Je n’arrivais pas à comprendre de quoi nous nous plaignions ; tout cela était trop abstrait, trop générique. Pour être sincère, la mondialisation ne me déplaisait pas, elle promettait de l’excellente musique, de beaux voyages.
Aujourd’hui encore, dire « mondialisation » me désoriente comme une idée vague, protéiforme. Mais j’arrive au moins à en deviner le périmètre, ses effets collatéraux la dessinent. Par exemple, une pandémie. Par exemple, cette nouvelle forme de responsabilité élargie, à laquelle aucun d’entre nous ne peut se soustraire.
Vraiment aucun. Si les êtres humains qui interagissent entre eux étaient reliés par des traits de stylo, le monde serait un unique et gigantesque gribouillis. En 2020, même l’ermite le plus rigoureux a un taux minimal de connexions. Nous vivons dans un graphe beaucoup, beaucoup plus connexe, pour employer le langage mathématique. Le virus suit les traits de stylo et arrive partout.
Cette méditation galvaudée de John Donne, « aucun homme n’est une île », prend dans la contagion une nouvelle et obscure signification.
Au supermarché
Un de mes amis a épousé une Japonaise. Ils vivent dans la région de Milan et ont une fillette de 5 ans. Pas plus tard qu’hier, mère et fille étaient au supermarché, et deux types se sont mis à hurler que tout était leur faute, qu’elles devaient retourner chez elles, en Chine.
La peur nous pousse à agir bizarrement. En 1982, année de ma naissance, le premier cas de sida était diagnostiqué en Italie. Mon père était alors un chirurgien de 34 ans. Au cours de cette première période, me raconte-t‑il, ses confrères et lui-même ignoraient comment se comporter, personne ne savait exactement ce qu’était ce virus. Quand il leur fallait opérer un patient malade, ils enfilaient deux paires de gants. Un jour, dans la salle d’opération, une goutte de sang d’une patiente séropositive est tombée de son bras par terre, et l’anesthésiste a bondi en arrière en criant.
C’étaient tous des médecins, et pourtant ils avaient peur. Personne n’est vraiment à la hauteur d’une tâche nouvelle. Dans le genre de circonstance que nous traversons, on observe toutes sortes de réactions : rage, panique, froideur, cynisme, incrédulité, résignation. Il suffirait de s’en souvenir pour ne pas oublier de faire preuve d’un peu plus de prudence que d’habitude, d’un peu plus de compassion. Et pour éviter de crier des insultes inconvenantes dans les rayons des supermarchés.
De toute façon – et au-delà de notre insurmontable difficulté à opérer des distinctions entre les traits asiatiques –, la contagion n’est pas entièrement « leur » faute. Si nous voulons vraiment désigner un coupable, c’est nous.
Une prophétie trop facile
Les virus comptent parmi les nombreux réfugiés de la destruction environnementale. A côté des bactéries, des champignons, des protozoaires. Si nous parvenions à nous défaire d’un peu de notre égocentrisme, nous constaterions que ce ne sont pas tant les nouveaux microbes qui viennent à nous, c’est plutôt nous qui les débusquons.
Le besoin croissant de nourriture pousse des millions d’individus à manger des animaux auxquels il vaudrait mieux ne pas toucher. En Afrique de l’Ouest, par exemple, la consommation de gibier potentiellement dangereux – dont les chauves-souris, qui, dans cette région, sont malheureusement les réservoirs du virus Ebola – est en augmentation.
Les contacts entre les chauves-souris et les gorilles, à travers lesquels Ebola peut se transmettre facilement à l’homme, sont favorisés par la surabondance de fruits mûrs sur les arbres, surabondance à son tour due à l’alternance de plus en plus violente de pluies anormales et de périodes de sécheresse, elle-même causée par le changement climatique…
On en a le vertige. Un enchaînement meurtrier de causes et d’effets. Or, les enchaînements de ce genre, qui sont légion, requièrent une réflexion urgente de la part d’individus de plus en plus nombreux. Car nous risquons de trouver à leur terme une nouvelle pandémie, encore plus terrible que celle-ci. Et parce que c’est nous, toujours nous, avec tous nos comportements, qui en sommes à l’origine.
Je me suis autorisé un peu d’emphase, au début, en affirmant que ce qui arrive s’est déjà produit et se reproduira. Ce n’était pas une prophétie improvisée. Ce n’était même pas une prophétie. Je peux même ajouter à présent, impartialement, que ce qui se produit avec le Covid-19 arrivera de plus en plus souvent. Parce que la contagion est un symptôme. L’infection réside dans l’écologie.
Il pleut sous le soleil
Dans les années 1980, les cheveux vaporeux étaient à la mode. Des hectolitres de laque étaient chaque jour pulvérisés dans l’air. Puis on a découvert que les chlorofluorocarbures ouvraient un trou dans l’ozonosphère et que, si nous n’agissions pas en conséquence, le soleil risquait de nous rôtir. Tout le monde a changé de coiffure et l’humanité a été sauvée.
Cette fois-là, nous avons été efficaces et coopératifs. Mais le trou de l’ozone était facile à imaginer, c’était un trou et nous sommes tous capables de visualiser un trou. Ce qu’on nous demande aujourd’hui de concevoir est, en revanche, beaucoup plus fuyant.
Voilà un paradoxe de notre époque : alors que la réalité devient de plus en plus complexe, nous devenons de plus en plus réfractaires à la complexité.
Prenons le changement climatique. L’augmentation de la température de la Terre est liée aux politiques sur le prix du pétrole et à nos projets de vacances, à l’extinction de la lumière dans le couloir et à la compétition économique entre la Chine et les Etats-Unis ; elle est liée à la viande que nous achetons au marché et à la déforestation sauvage. Le personnel et le global s’entrelacent de manière si énigmatique que nous sommes épuisés avant même d’avoir ébauché un raisonnement. (…)
La seule certitude, en fin de compte, c’est que notre cerveau ne semble pas suffisamment équipé. Mais nous aurions intérêt à l’équiper en toute hâte. Parmi les maladies qui pourraient bénéficier du climate change figurent, en dehors d’Ebola, la malaria, la dengue, le choléra, la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental et même la diarrhée, qui, si elle représente une gêne négligeable chez nous, constitue ailleurs un péril très sérieux. Le monde s’apprête à se conchier.
La contagion est donc une invitation à réfléchir. La quarantaine en offre l’occasion. Réfléchir à quoi ? Au fait que nous n’appartenons pas seulement à la communauté humaine. Nous sommes l’espèce la plus envahissante d’un fragile et superbe écosystème.
Parasites
Je passe mes étés dans le Salento, à la pointe sud-est de la région des Pouilles. Quand, de loin, je pense à ces lieux, et cela m’arrive souvent, les oliviers me viennent aussitôt à l’esprit. Sur la route qui mène d’Ostuni à la mer, il y a des spécimens si anciens et si majestueux qu’on n’a pas l’impression d’avoir affaire à des végétaux. Ils ont des troncs expressifs, ils paraissent sensibles. J’ai parfois cédé, moi aussi, au désir magique d’en étreindre un pour lui voler un peu de sa force.
Xylella fastidiosa a fait irruption près de Gallipoli en 2010. De là, elle a entamé sa marche patiente vers le nord, infectant les oliviers, kilomètre après kilomètre. Au début, leur feuillage semblait avoir été brûlé par le soleil, mais, avec le temps, les arbres se sont transformés en squelettes. L’été dernier, en roulant sur la voie express de Brindisi à Lecce, j’ai vu des cimetières d’arbres gris.
Et pourtant, dix années n’ont pas suffi à mettre tout le monde d’accord.
Xylella existe.
Non, Xylella n’existe pas.
(…) Entre-temps, le parasite avance, il se multiplie tranquillement. Il apparaît à Antibes, en Corse, à Majorque. Xylella aime les vacances.
Experts
4 mars. Le gouvernement vient d’annoncer la fermeture des écoles dans toute l’Italie, et je me suis déjà disputé avec deux ou trois personnes. Dans la contagion, on se dispute surtout à propos de la différence entre le Covid-19 et la grippe saisonnière. Mais aussi à propos des mesures de confinement, jugées trop faibles ou excessives.
Il en est ainsi depuis le début : il y a, d’un côté, les gens qui soulignent la propension du virus à vous envoyer à l’hôpital ; de l’autre, ceux qui en parlent comme d’un rhume très surévalué. Ceux qui disent de se laver les mains un peu plus souvent que d’habitude, rien de plus, et ceux qui demandent que le pays entier soit placé en quarantaine. « Selon les experts », « la parole aux experts », « mais les experts pensent que ».
« Ce qui est sacré dans la science, c’est la vérité », écrivait Simone Weil. Mais quelle est la vérité lorsqu’on interroge les mêmes données, partage les mêmes modèles et arrive à des conclusions opposées ?
Dans la contagion, la science nous a déçus. Nous voulions des certitudes et nous avons trouvé des opinions. Nous avons oublié que cela marche toujours ainsi, ou plutôt que cela ne marche qu’ainsi, que le doute est pour la science encore plus sacré que la vérité. A présent, cela ne nous intéresse pas. Nous regardons les spécialistes se quereller, comme des enfants assistant aux disputes de leurs parents, de bas en haut. Puis nous nous querellons entre nous.
Le dieu Pan
Quand les quotidiens ont décidé de ne plus publier le nombre des contagions sur leur page d’accueil, j’ai éprouvé un sentiment de mécontentement et de trahison. J’ai commencé à en consulter d’autres. Dans la contagion, l’information transparente n’est pas un droit : c’est une prophylaxie essentielle.
Plus un Susceptible est informé – sur les chiffres, les lieux, la concentration de patients dans les hôpitaux –, plus son attitude sera appropriée au contexte. (…)
Et pourtant, dès les premiers jours, on a accusé les chiffres de semer la panique. Mieux valait donc les occulter, ou trouver une méthode de calcul pour les minimiser. Quitte à s’apercevoir juste après que, de la sorte, la panique se déchaînait vraiment : si l’on nous cache la vérité, c’est que les choses sont beaucoup plus graves qu’il n’y paraît. Au bout de deux jours, les chiffres ont ressurgi sur les pages d’accueil, et y sont restés.
Ces dérapages sont le signe d’une relation irrésolue. D’un triangle sentimental qui s’est apparemment enrayé dans la modernité, où citoyens, institutions et experts sont incapables de s’aimer.
Si les institutions se fient aux experts, elles ne se fient pas autant à nous autres citoyens, à notre résistance émotive. Les experts n’ont pas non plus une grande confiance en nous, ils nous parlent d’une façon trop simple, que nous jugeons suspecte. Quant aux institutions, nous les soupçonnions déjà avant et nous continuerons de les soupçonner ensuite. Voilà pourquoi nous souhaiterions nous rapprocher des experts, mais nous les voyons vaciller. Dans l’incertitude, nous finissons par adopter des comportements encore pires, attirant la méfiance sur nous.
Le virus a révélé ce cercle vicieux, une boucle de méfiance qui se produit presque chaque fois que la science effleure notre quotidien. C’est de cette boucle, non des chiffres, que naît la panique “.
[1] Personne passionnée de sciences et techniques, notamment d’informatique, et qui y consacre la plus grande partie de son temps.


